


Dans une belle confusion réglementaire, les Organismes Génétiquement Modifiés colonisent progressivement nos assiettes. Et si la résistance commençait dans les cantines ?
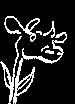 Si
les biotechnologies sont censées suggérer un futur radieux
et d’abondance, la législation européenne sur l'étiquetage
des OGM évoque plutôt une passoire trouée. Ainsi, le
règlement 25/8/97 entré en vigueur le 15 mai 1997 prévoit
l'étiquetage des produits qui sont des OGM ou qui en contiennent,
mais pas de ceux «issus d'OGM et n'en contenant plus».
Par exemple, une huile obtenue à partir d'OGM et dont l'ADN se trouve
éliminé par le processus de fabrication ne sera ni évaluée,
ni étiquetée. Pas plus que tous les aliments transgéniques
«substantiellement équivalents» (composition,
valeur nutritionnelle, usage) aux produits classiques. Quant aux additifs,
agents de saveur et autres adjuvants (enzymes...), ils sont exclus d'un
étiquetage uniquement destiné à informer sur la composition
finale des produits et non sur le procédé de production.
Un bœuf pourra être nourri au maïs transgénique, on n'en
saura rien. Enfin, compte tenu des méthodes de détection
retenues (fragments d'ADN et protéines modifiés), Steve Emmot
du groupe des Verts au Parlement européen estime que plus de 60
% des aliments contenant des ingrédients issus du génie génétique
échapperont à l'étiquetage1. À
croire que l'on redoute l'effet de la mention «génétiquement
modifié» sur le consommateur. Bizarre pour des produits
réputés inoffensifs 2.
Si
les biotechnologies sont censées suggérer un futur radieux
et d’abondance, la législation européenne sur l'étiquetage
des OGM évoque plutôt une passoire trouée. Ainsi, le
règlement 25/8/97 entré en vigueur le 15 mai 1997 prévoit
l'étiquetage des produits qui sont des OGM ou qui en contiennent,
mais pas de ceux «issus d'OGM et n'en contenant plus».
Par exemple, une huile obtenue à partir d'OGM et dont l'ADN se trouve
éliminé par le processus de fabrication ne sera ni évaluée,
ni étiquetée. Pas plus que tous les aliments transgéniques
«substantiellement équivalents» (composition,
valeur nutritionnelle, usage) aux produits classiques. Quant aux additifs,
agents de saveur et autres adjuvants (enzymes...), ils sont exclus d'un
étiquetage uniquement destiné à informer sur la composition
finale des produits et non sur le procédé de production.
Un bœuf pourra être nourri au maïs transgénique, on n'en
saura rien. Enfin, compte tenu des méthodes de détection
retenues (fragments d'ADN et protéines modifiés), Steve Emmot
du groupe des Verts au Parlement européen estime que plus de 60
% des aliments contenant des ingrédients issus du génie génétique
échapperont à l'étiquetage1. À
croire que l'on redoute l'effet de la mention «génétiquement
modifié» sur le consommateur. Bizarre pour des produits
réputés inoffensifs 2.
Quand les produits sont bons, ça peut pas faire de mal
C'est qu'il s'agit d'un marché conséquent : 35 millions
d'hectares cultivés dans le monde pour quelques centaines de millions
de dollars. Et que les principaux acteurs en sont des firmes assez balèzes
: Monsanto, Pionner, Agrevo, Novartis ou Zeneca se portent bien, merci3.
Les milliards qu'ils ont mobilisés exigent un retour sur investissement
rapide, aussi les Européens seraient-ils mal inspirés de
chipoter sur les étiquettes. Leurs pressions, tout comme celles
des États-Unis ou de lobbies comme l’Association Générale
des Producteurs de Maïs, ne sont certainement pas  pour
rien dans les les choix réglementaires. Ainsi, l’AGPM met en vedette
«Kamana
le maïs doux», «l’ami des enfants», dans
une bédé vantant le maïs transgénique. Tout ceci
concourt à réunir les conditions de l’implantation des OGM
et donc à accentuer le productivisme et l’intégration de
l’agriculture à l’oligopôle bio-chimique. Or, cette implantation
serait plus irréversible qu’avec le nucléaire : les animaux
et les plantes n’ont guère de complexes sur leur reproduction...
pour
rien dans les les choix réglementaires. Ainsi, l’AGPM met en vedette
«Kamana
le maïs doux», «l’ami des enfants», dans
une bédé vantant le maïs transgénique. Tout ceci
concourt à réunir les conditions de l’implantation des OGM
et donc à accentuer le productivisme et l’intégration de
l’agriculture à l’oligopôle bio-chimique. Or, cette implantation
serait plus irréversible qu’avec le nucléaire : les animaux
et les plantes n’ont guère de complexes sur leur reproduction...
Consommateurs captifs et paysans otages
Mais l'Europe n'est pas encore submergée par les OGM et il est
encore temps d'agir. Notamment dans les lieux où l'on ne choisit
pas ses aliments, comme dans la restauration collective. À Paris,
par exemple, la FCPE a obtenu d’associer le voeu de refuser les produits
“étiquetés” dans l'appel d'offre de la Caisse des écoles
du XIème. Difficile de faire plus, puisque l'appel se fait à
l'échelle européenne, sauf à recourir à la
filière biologique. En effet, elle est la seule véritablement
sans OGM et constitue une relative assurance contre la vache folle ou l'excès
de nitrates. Et comme elle dispose d'un label européen, ça
roule. Reste la question du surcoût par rapport aux autres filières.
Sur un repas revenant à 40 f, payé 22 f par les parents,
il n'y a que 8 f de denrées : mettons 20 % de différence
; 1,60 f de plus par repas. C'est peut-être jouable. En tout cas,
cela fait un moment que le tour est joué au Resto-U de Lorient.
Chaque jour, 150 à 200 repas 100 % bio sont servis, parallèlement
aux menus classiques, pour les mêmes 14,50 f. Certes, les portions
sont un peu moins grosses et un jour sur deux c'est végétarien,
mais c'est complet et équilibré. À une échelle
plus réduite, les cas de partenariat “producteur-consommateur” entre
municipalités, écoles et paysans se multiplient, notamment
en Alsace ou dans la Drôme. Les Verts et les Alternatifs aussi s'engagent
dans de telles actions. En revanche, la restauration hospitalière
semble moins mobiliser. Dommage, car par ce biais on s'attaque à
l'offensive OGM sur au moins deux terrains : la santé publique (revendication
d'une détection, d'une traçabilité et d'un étiquetage
fiables, sinon de l’interdiction des OGM) et un modèle d’agriculture
durable. Développer les agricultures paysannes4et
biologique, directement menacées par les OGM (dissémination,
mélange des lots...), c'est toujours ça que les gros céréaliers
gavés de subventions n’auront pas. Même si cela laisse de
côté la question du brevetage du vivant. Mais c'est là
un tout autre problème, non ?
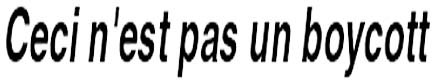
Après les baleiniers et les nucléocrates,
Greenpeace a décidé de faire chier l'industrie agro-alimentaire.
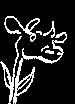
 Pour
se faire entendre des multinationales, le plus simple est d'appuyer là
où ça chatouille : l'image de marque et le chiffre d'affaire.
C'est le constat qui a conduit Greenpeace France à monter son «Réseau
info-conso OGM» et ses trois listes1 susceptibles
de faire frémir les géants de l'agro-alimentaire : la «liste
blanche» concerne «les produits pour lesquels les fabricants
garantissent l'absence d'OGM (soumis ou non à la loi sur l'étiquetage)»,
la «liste grise» ceux dont «les fabricants
ne peuvent garantir formellement l'absence d'OGM» et la redoutable
«liste
noire» ceux «susceptibles de contenir des OGM ou dont
les fabricants ne s'opposent pas à la présence d'OGM (soumis
ou non à la loi sur l’étiquetage)».
«L'objectif
principal, c'est plus du tout de nourriture avec OGM», précise
Ruth Baenziger, responsable du Réseau. Mais c'est aussi, dans l'immédiat,
«faciliter
l'approvisionnement dans les filières sans OGM et faire pression
sur les fabricants pour qu'ils se prononcent sur les OGM». De
ce côté, difficile de s'en remettre à l'étiquetage
légal, véritable passoire à lécithine de soja...
Pour
se faire entendre des multinationales, le plus simple est d'appuyer là
où ça chatouille : l'image de marque et le chiffre d'affaire.
C'est le constat qui a conduit Greenpeace France à monter son «Réseau
info-conso OGM» et ses trois listes1 susceptibles
de faire frémir les géants de l'agro-alimentaire : la «liste
blanche» concerne «les produits pour lesquels les fabricants
garantissent l'absence d'OGM (soumis ou non à la loi sur l'étiquetage)»,
la «liste grise» ceux dont «les fabricants
ne peuvent garantir formellement l'absence d'OGM» et la redoutable
«liste
noire» ceux «susceptibles de contenir des OGM ou dont
les fabricants ne s'opposent pas à la présence d'OGM (soumis
ou non à la loi sur l’étiquetage)».
«L'objectif
principal, c'est plus du tout de nourriture avec OGM», précise
Ruth Baenziger, responsable du Réseau. Mais c'est aussi, dans l'immédiat,
«faciliter
l'approvisionnement dans les filières sans OGM et faire pression
sur les fabricants pour qu'ils se prononcent sur les OGM». De
ce côté, difficile de s'en remettre à l'étiquetage
légal, véritable passoire à lécithine de soja...
Mon Dany est-il transgénique ?
Comme l'appel au boycott est illégal en France, Greenpeace table
sur la diffusion des listes et l'incitation à harceler les firmes
(Nestlé, Unilever, Danone...) plutôt que les semenciers. Le
consommateur devrait plus se motiver pour modifier ses achats courants.
Ceinture sur le Galak et les Dany au chocolat mais, et c'est appréciable,
Greenpeace, «essaye le plus possible de trouver des produits à
coût équivalent et qu'on puisse trouver dans les grandes surfaces».
Cela dit, la «liste blanche» n'est pas encore squattée
par Leader Price. Dommage, car «un des objectifs est d'avoir des
filières sans OGM qui ne soient pas plus chères. Il n'y a
aucune raison de payer plus cher quelque chose qu'on avait avant et qui
était sûr, à cause de technologies très coûteuses
et qu'on nous impose». En Allemagne, l'équivalent du Réseau
rassemble déjà 200 000 à 300 000 personnes, le Luxembourg
et l'Autriche résistent toujours aux OGM... Le Maccarthysme alimentaire
à de beaux jours devant lui.
Greenpeace France : 21, rue Godot de Mauroy 75009 Paris.

La Confédération Paysanne lutte contre le productivisme. Quand les semenciers et la justice s'en mêlent, elle brandit sa fourche.
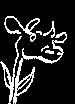 Le
8 janvier 1998, trois militants de la Conf’ comparaissaient devant le tribunal
d'Agen pour d'inqualifiables actes de sabotage : la neutralisation de semences
de maïs Novartis à coups de lance à incendie, à
Nérac. Depuis qu'elle a transformé l'audience en procès
des OGM, occasionnant le premier débat sur le fond de l'affaire,
la Conf' ne se démobilise pas. Avec les premiers ensemencements
en variétés modifiées, on a vu ses militants envahir
Auchan à La Défense et dénoncer avec Greenpeace le
non-étiquetage d'aliments contenant des OGM ; on voit fleurir des
panneaux «Pas d'OGM dans ce champ» ; on verra des paysans
s'inviter sur les parcelles mises en OGM...
Le
8 janvier 1998, trois militants de la Conf’ comparaissaient devant le tribunal
d'Agen pour d'inqualifiables actes de sabotage : la neutralisation de semences
de maïs Novartis à coups de lance à incendie, à
Nérac. Depuis qu'elle a transformé l'audience en procès
des OGM, occasionnant le premier débat sur le fond de l'affaire,
la Conf' ne se démobilise pas. Avec les premiers ensemencements
en variétés modifiées, on a vu ses militants envahir
Auchan à La Défense et dénoncer avec Greenpeace le
non-étiquetage d'aliments contenant des OGM ; on voit fleurir des
panneaux «Pas d'OGM dans ce champ» ; on verra des paysans
s'inviter sur les parcelles mises en OGM...
À la Monsanto, surveille tes silos
Forcément, ça fait tache dans le débat policé
entre experts dévoués au génie génétique.
Lorsque la Conférence de consensus (juin 98) tourne à la
mascarade et que Jean-Yves Ledéaut, président de l'OPECST1désavoue
ses timides réserves, la Conf’ souligne l'indigence des protocoles
de «biovigilance» et des études sur les risques
autres qu'environnementaux (allergiques, toxicologiques). Pour René
Riesel, secrétaire national, un des “trois de Nérac”, «la
recherche publique devrait avoir un rôle de contre-expertise systématique,
or, avec la généralisation des joint-ventures etc., il n’y
a pas un chercheur qui puisse se dire indépendant aujourd’hui».
Dans ces conditions, difficile de rappeler que la solution à
la faim dans le monde, ce ne sont pas les OGM, mais bien «une
autre répartition des richesses». Qu’ils «ne
volent qu’au secours de l’agriculture productiviste : les pratiques respectueuses
de l’environnement n’en ont pas besoin». Le cas du maïs
résistant à la pyrale est exemplaire : ce ravageur détruit
7 % de la production française, mais c’est bien la monoculture intensive,
l’abus de désherbants... qui accentue son développement.
«Si
on cherchait des rendements plus raisonnables, on gagnerait doublement
: on utiliserait moins de pesticides et on n’aurait pas “besoin” d’OGM
pour limiter le recours aux pesticides». Ce qui ne serait pas
une mauvaise idée, vu le nombre de morts par empoisonnement chez
les paysans...
À la Novartis, gare à la tremblante du maïs
Si les agriculteurs sont à ce point engagés dans l’ultra-productivisme,
c’est que la Politique Agricole Commune continue à pousser à
la production et à la soutenir artificiellement sur les cours internationaux.
Tant pis pour les pays du Sud. Certes, la loi d’orientation agricole et
la réforme de la PAC sont censées aller vers «plus
d’environnement et plus d’emplois agricoles». Mais l’encouragement
des OGM et la volonté de maintenir les exportations montrent jusqu’où
l’État et l’UE sont prêts à aller... En attendant,
la Conf’ prépare son offensive anti OGM de printemps, notamment
en direction des parcelles mises en OGM ou destinées aux expérimentations
en grandeur réelle. Entre les gros bras de la FNSEA et le quasi
“secret défense” qui entoure la localisation des champs incriminés2, les
obstacles sont nombreux. Cela ne devrait pas empêcher la Conf’ de
se battre pour «un moratoire sur chaque OGM, aussi long qu’il
le faudra, pour vérifier qu’ils ne présentent pas de risque
environnemental, allergique, toxicologique... et qu’ils ont bien une “utilité
sociale”». Pour une fois que des paysans proposent une alternative
à l’immolation de pneus et au déversement de lisier sur la
voie publique, c’est plutôt une bonne nouvelle.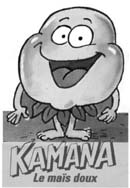
L’image du titre a été chourée sur le site ouaibe
de Monsanto.
 |
|
|
 |
|