 
Le 6 décembre 1998, Hugo Chávez Frías
était élu président de la République du Venezuela.
La presse française avait tranché : encore une victoire du
populisme
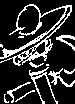 «Hugo
Chávez, la lame de fond populiste. L'ex-putschiste est favori à
la présidentielle vénézuélienne»,
titrait Libération le samedi 5 décembre 98. Volontiers
comparé à Alberto Fujimori et à Carlos Menem, Chávez
constituerait un danger pour la démocratie. Même si le personnage
est effectivement ambigu, le quotidien nourrissait là un lieu commun
de la politique latino-américaine, le militaro-populisme, et passait
sous silence des évolutions politiques de fond. En l'occurrence,
la percée nationale et régionale d'un pôle de gauche
au «Hugo
Chávez, la lame de fond populiste. L'ex-putschiste est favori à
la présidentielle vénézuélienne»,
titrait Libération le samedi 5 décembre 98. Volontiers
comparé à Alberto Fujimori et à Carlos Menem, Chávez
constituerait un danger pour la démocratie. Même si le personnage
est effectivement ambigu, le quotidien nourrissait là un lieu commun
de la politique latino-américaine, le militaro-populisme, et passait
sous silence des évolutions politiques de fond. En l'occurrence,
la percée nationale et régionale d'un pôle de gauche
au  détriment
des deux partis traditionnels : Acción Democrática
(AD, socio-démocrates devenus socio-libéraux) et le Comité
pour l’organisation populaire électorale indépendante (COPEI,
démocrates-chrétiens). détriment
des deux partis traditionnels : Acción Democrática
(AD, socio-démocrates devenus socio-libéraux) et le Comité
pour l’organisation populaire électorale indépendante (COPEI,
démocrates-chrétiens).
Ni Pinochet, ni Guevara : Chávez
C'est vrai, Chávez réunit tous les ingrédients
du parfait connard (hijo de puta, comme on dit là-bas). Militaire,
ancien putschiste, il a, en février 1992, tenté de renverser
un gouvernement certes démocratique mais entièrement dévoué
au FMI. Ce coup de force manqué relayait une vague de contestation
qui avait commencé avec les émeutes de février 89,
et dont la répression avait fait 2 000 morts parmi les civils. Démocratique,
donc. L'ampleur de la secousse a permis de débloquer un système
politique figé. En effet, depuis 40 ans, un “pacte” garantissait
des alternances au pouvoir pour AD et le COPEI. Conclu pour éviter
toute tentative dictatoriale, il a abouti à une répartition
mafieuse du pouvoir. La relative popularité dont Chávez a
bénéficié pour y avoir mis fin lui a ouvert, six ans
plus tard, la voie de la présidence.
Si sur la forme, sa campagne évoque surtout un best-off des
Grosses
têtes, elle est sur le fond nettement orientée à
gauche. Ainsi, la coalition qui le soutient actuellement compte un certain
nombre d'infréquentables qui rêvent de mettre à mal
les privilèges de l’élite au pouvoir. Chávez et ses
alliés font peur. Le Movimiento Al Socialismo (MAS), parti
fondé par d'anciens communistes ayant abandonné la lutte
armée à la fin des années 60, est une formation social-démocrate
actuellement dominée par son aile gauche. L’autre parti de la coalition,
Patria Para Todos (PPT), n'a pas franchement bonne presse dans les
beaux quartiers. Sa gestion municipale s'apparente au budget participatif
1instauré
par le Parti des Travailleurs brésilien à Porto Allegre.
En fevrier 1992, il a appuyé le soulèvement chaviste dont
il approuvait la dimension “sociale”. N'en déplaise à ceux
qui voient la dictature se profiler à l'horizon, il s'agit de tout
sauf d'affreux autoritaristes. Même le mythique Douglas Bravo 2,
devenu selon ses propres mots un “guérillero de l'écologie”,
n'a pas hésité à apporter son  soutien
à la coalition. Déjà, des commissions planchent sur
un arrêt des politiques de concessions actuellement en vigueur, notamment
dans le secteur minier. Soucieux de se procurer des recettes fiscales à
court terme, les gouvernements précédents cédaient
des pans entiers de forêt à des multinationales, tel le canadien
Monarch, à la recherche d'or dans la Guyane vénézuélienne. soutien
à la coalition. Déjà, des commissions planchent sur
un arrêt des politiques de concessions actuellement en vigueur, notamment
dans le secteur minier. Soucieux de se procurer des recettes fiscales à
court terme, les gouvernements précédents cédaient
des pans entiers de forêt à des multinationales, tel le canadien
Monarch, à la recherche d'or dans la Guyane vénézuélienne.
Quand les partis politiques vont, tout va !
La presse française a également insisté sur l'inquiétante
situation des deux partis politiques traditionnels qui ont ramassé
la gamelle de leur vie aux présidentielles. Cette “disparition”
de la scène politique, d'ailleurs toute relative 3, ferait
courir un danger à la démocratie vénézuélienne.
Mais voyons comment ces démocrates patentés ont abordé
les élections.
|
Un an avant les élections, le COPEI est aux anges. Promue candidate
de ce parti, Irene Sáez, la très populaire (ex) Miss Univers,
se lance à l'assaut de la présidence. Au fil des meetings,
la reine de beauté doit s’exprimer. Elle entame alors une lente
descente dans les sondages et plafonne, à une semaine du scrutin...
à 3 % des intentions de vote. Solution : l'état-major démo-chrétien
renvoie Blanche-Neige dans son château trois jours avant les élections.
Côté Acción Democrática, pas de souci.
Faute de candidat valable, on envoie au casse-pipe Luis Afaro Ucero, secrétaire
général du parti et vieil apparatchik, histoire de perdre
honorablement face à Miss Univers et de conclure une alliance parlementaire
pour gouverner avec les démo-chrétiens. Mais papi ne fait
pas rêver : il culmine à 1,5 % d’intentions de vote. Et les
vieux, c'est connu, c’est hargneux et ça s'accroche à son
investiture. Qu'à cela ne tienne : dans la semaine qui précède
le scrutin, AD exclut ce candidat têtu. Sommet du ridicule, les deux
partis se rallient à la candidature d'Enrique Salas Römer.
En bon propriétaire terrien, ce dissident de la démocratie
chrétienne et seul vrai concurrent de Chávez avait fait sa
campagne à cheval, la tête ornée d'un chapeau. À
cette date, le tarjetón, sorte de grand bulletin de vote
où figurent les noms et les photos de tous les candidats, est déjà
imprimé. Pas grave. On s'arrange avec l'autorité électorale
et on explique : «si tu coches Miss Univers ou candidat exclu
de son parti, ça vaut pour monsieur sur cheval avec chapeau».
Chapeau marron et béret rouge
Cette conjoncture tout à fait inédite est l'occasion
d’opérer des changements structurels dans la société
vénézuélienne. D’autant qu’il n’est guère besoin
de faire la Révolution pour opérer une révolution
là où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
De plus, sachant que le Venezuela est le premier fournisseur de pétrole
des États-Unis, on devine quelle serait la réaction de l'Oncle
Sam face à un quelconque processus révolutionnaire en “bonne
et due forme”. C'est un des éléments qui permettent de comprendre
l’alliance baptisée Polo Patriotico 4,
qui lie l’ancien militaire à la gauche vénézuélienne.
Au niveau régional cette  stratégie
a priori hasardeuse a payé : car la formation du Polo Patriótico
dirige 9 États 5sur
les 22 que compte la Fédération. Gourmand, Chávez
veut en ajouter un dixième. Désormais habitué du grand
écart, il a récemment proposé l’appui de son parti
à... Miss Univers, repartie pour un tour à l’occasion d’une
prochaine régionale anticipée ! Certes, il faudra attendre
le résultat du processus constitutionnel qui sera engagé
dans le courant de l'année pour lever l'hypothèque d'une
dérive autoritaire du régime. Mais, là encore, les
comparaisons avec le Pérou de Fujimori ou l'Argentine de Menem paraissent
un peu forcées. Si Fujimori a dû faire un autogolpe6pour
imposer ses vues et si Menem a réformé la Constitution argentine
à la hâte pour s'offrir un mandat supplémentaire, la
réforme constitutionnelle de Chávez était, dès
le départ, inscrite dans son programme. Mais certains clichés
sont plus vendeurs que d'autres. En cas de victoire de son principal concurrent,
Enrique Salas Römer, Libération aurait-il titré
«Salas
Römer, la lame de fond patronale. Le propriétaire terrien qui
se balade sur un cheval avec un chapeau ridicule est favori à la
présidentielle vénézuélienne»
? Il
est permis d’en douter. Salas Römer, lui, ne fait peur à personne. stratégie
a priori hasardeuse a payé : car la formation du Polo Patriótico
dirige 9 États 5sur
les 22 que compte la Fédération. Gourmand, Chávez
veut en ajouter un dixième. Désormais habitué du grand
écart, il a récemment proposé l’appui de son parti
à... Miss Univers, repartie pour un tour à l’occasion d’une
prochaine régionale anticipée ! Certes, il faudra attendre
le résultat du processus constitutionnel qui sera engagé
dans le courant de l'année pour lever l'hypothèque d'une
dérive autoritaire du régime. Mais, là encore, les
comparaisons avec le Pérou de Fujimori ou l'Argentine de Menem paraissent
un peu forcées. Si Fujimori a dû faire un autogolpe6pour
imposer ses vues et si Menem a réformé la Constitution argentine
à la hâte pour s'offrir un mandat supplémentaire, la
réforme constitutionnelle de Chávez était, dès
le départ, inscrite dans son programme. Mais certains clichés
sont plus vendeurs que d'autres. En cas de victoire de son principal concurrent,
Enrique Salas Römer, Libération aurait-il titré
«Salas
Römer, la lame de fond patronale. Le propriétaire terrien qui
se balade sur un cheval avec un chapeau ridicule est favori à la
présidentielle vénézuélienne»
? Il
est permis d’en douter. Salas Römer, lui, ne fait peur à personne.
Aquilès
1 Voir VF nº 16. (retour)
2 Figure de la guérilla guévariste vénézuélienne,
ayant déposé les armes en 1978. (retour)
3 Ils restent assez bien implantés localement et AD demeure
le premier parti au Parlement.
(retour)
4 Cartel électoral composé principalement du Movimiento
V República (MVR) de Chávez, le MAS et le PPT. (retour)
5 Dont deux seulement pour le parti de Chávez. (retour)
6 Coup d'état institutionnel.
(retour)
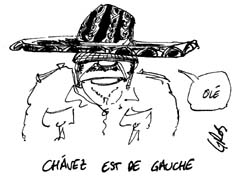
|

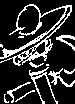 «Hugo
Chávez, la lame de fond populiste. L'ex-putschiste est favori à
la présidentielle vénézuélienne»,
titrait Libération le samedi 5 décembre 98. Volontiers
comparé à Alberto Fujimori et à Carlos Menem, Chávez
constituerait un danger pour la démocratie. Même si le personnage
est effectivement ambigu, le quotidien nourrissait là un lieu commun
de la politique latino-américaine, le militaro-populisme, et passait
sous silence des évolutions politiques de fond. En l'occurrence,
la percée nationale et régionale d'un pôle de gauche
au
«Hugo
Chávez, la lame de fond populiste. L'ex-putschiste est favori à
la présidentielle vénézuélienne»,
titrait Libération le samedi 5 décembre 98. Volontiers
comparé à Alberto Fujimori et à Carlos Menem, Chávez
constituerait un danger pour la démocratie. Même si le personnage
est effectivement ambigu, le quotidien nourrissait là un lieu commun
de la politique latino-américaine, le militaro-populisme, et passait
sous silence des évolutions politiques de fond. En l'occurrence,
la percée nationale et régionale d'un pôle de gauche
au  détriment
des deux partis traditionnels : Acción Democrática
(AD, socio-démocrates devenus socio-libéraux) et le Comité
pour l’organisation populaire électorale indépendante (COPEI,
démocrates-chrétiens).
détriment
des deux partis traditionnels : Acción Democrática
(AD, socio-démocrates devenus socio-libéraux) et le Comité
pour l’organisation populaire électorale indépendante (COPEI,
démocrates-chrétiens).
 soutien
à la coalition. Déjà, des commissions planchent sur
un arrêt des politiques de concessions actuellement en vigueur, notamment
dans le secteur minier. Soucieux de se procurer des recettes fiscales à
court terme, les gouvernements précédents cédaient
des pans entiers de forêt à des multinationales, tel le canadien
Monarch, à la recherche d'or dans la Guyane vénézuélienne.
soutien
à la coalition. Déjà, des commissions planchent sur
un arrêt des politiques de concessions actuellement en vigueur, notamment
dans le secteur minier. Soucieux de se procurer des recettes fiscales à
court terme, les gouvernements précédents cédaient
des pans entiers de forêt à des multinationales, tel le canadien
Monarch, à la recherche d'or dans la Guyane vénézuélienne.
 stratégie
a priori hasardeuse a payé : car la formation du Polo Patriótico
dirige 9 États
stratégie
a priori hasardeuse a payé : car la formation du Polo Patriótico
dirige 9 États 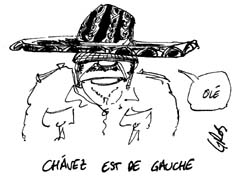


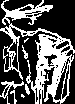 Interpol
ne manque pas d'humour : organiser, les 23 et 24 février,
sa quatrième conférence internationale sur l'héroïne
à Rangoon, c'est un peu comme réunir une conférence
sur les droits de la Femme à Kaboul. Non seulement la Birmanie est
le premier producteur d'héroïne au monde, mais son armée
est aussi notoirement impliquée dans le trafic de stupéfiants
et le blanchiment de l'argent de la drogue 1. Mieux : elle abrite
Khun Sa et Lo Hsing Han, deux trafiquants d'héroïne officiellement
à la retraite. Ayant en réalité engagé leurs
capitaux dans une collaboration étroite avec le régime militaire,
ils sont sous le coup d’un mandat d'arrêt lancé par... Interpol.
Comble de l'ironie, les rumeurs les plus folles courent sur les hôtels
où résideront les conférenciers. Le secteur hôtelier
de luxe n’est-il pas «un des principaux moyens de blanchissement
de l’argent de la drogue en Birmanie»2.
Interpol
ne manque pas d'humour : organiser, les 23 et 24 février,
sa quatrième conférence internationale sur l'héroïne
à Rangoon, c'est un peu comme réunir une conférence
sur les droits de la Femme à Kaboul. Non seulement la Birmanie est
le premier producteur d'héroïne au monde, mais son armée
est aussi notoirement impliquée dans le trafic de stupéfiants
et le blanchiment de l'argent de la drogue 1. Mieux : elle abrite
Khun Sa et Lo Hsing Han, deux trafiquants d'héroïne officiellement
à la retraite. Ayant en réalité engagé leurs
capitaux dans une collaboration étroite avec le régime militaire,
ils sont sous le coup d’un mandat d'arrêt lancé par... Interpol.
Comble de l'ironie, les rumeurs les plus folles courent sur les hôtels
où résideront les conférenciers. Le secteur hôtelier
de luxe n’est-il pas «un des principaux moyens de blanchissement
de l’argent de la drogue en Birmanie»2.

